
C’était une fin de journée comme on en connaît dans nos régions, l’atmosphère comme du miel, avec une lumière rasante allumant de tons orangers nos maisons de brique rose et ces crêpis qui ont gardé la couleur blonde des sables de Garonne.

À l’Angélus sonné au clocher de Saint-Jacques, les autres s’étaient dispersés. Tous, sauf nous quatre. Nous étions là tous âges confondus, à cette heure entre chien et loup où ce n’est plus la journée et pas encore le soir.
Maurice, c’était notre chef. Treize ans montés en graine, un visage ingrat où la barbe naissante semait un duvet noir ressemblant à de la crasse. Roland, figure de pleine lune, corps rondouillard.

Enfin, Jeannot, capable de tout pour me protéger, moi la benjamine qui m’attachais à ses pas, ombre minuscule et grassouillette.
Lequel d’entre nous avait eu l’idée de tirer les sonnettes ? Dans la douceur de l’air et de l’amitié partagée, elle semblait avoir jailli au même moment de nos quatre têtes, l’idée ! Eux avaient l’habitude. Moi, c’était la première fois que je jouais à un jeu aussi excitant, même si j’étais un peu en dehors du coup, à cause de mes petites jambes. Déjà, ils avaient choisi chacun sa porte. Trois portes en vis-à-vis, celles des trois viragos : Madame Dargen, une vieille femme confite dans le fiel qui semait des traînées de discorde dans le quartier; la Trottignon qui avait empoisonné Kiki, le chien de Maurice, pour le guérir de venir, chaque jour, pisser contre sa porte ; Mme Duguez, la femme du chef de gare, originaire de la ville qui s’était mis en tête de nous civiliser.

Accotés chacun à son chambranle, ils inspectaient la rue du même regard incisif, puis, du même mouvement, s’appuyaient de tout leur poids chacun sur son bouton de sonnette. Déjà, ils avaient détalé, l’un vers la rue Gamot toute proche, l’autre vers l’impasse derrière la boulangerie qui communique avec la place Lalaque par les jardins, le troisième dans le couloir d’un immeuble voisin. Le temps de prendre conscience du danger et j’avais pris mon envol vers le refuge de l’atelier, mais je n’avais pas fait trois pas qu’elles étaient là. Penchant de très haut leurs visages grimaçants, énormes sur la toile éblouissante du ciel avec leurs doigts immenses pointés vers moi, elles me saisissaient et me rejetaient tout à tour. Je ballottais, tombant vers l’une, vers l’autre, ivre de vertige. Le filtre de ma peur ne laissait passer que leur haine.

C’était encore la fille de l’Espagnol. Espagnol du diable ! Le Rouge ! Une fois finie la guerre d’Espagne, il était venu la porter chez nous avec ses habitudes différentes, son parler tumultueux, et cette smala qui vivait accrochée à ses basques. C’était comme cette sale gosse. On ne comptait plus ses sottises. Les chewing-gums ramassés par terre et remâchés au mépris de toute hygiène, -mais l’hygiène, on sait où ils se la mettent, ces gens-là!-, les vitres éclatées à coups de ballon, les blagues faites à Pierre, à Paul, les bagarres à coups de pied, à coups de poing. Une vraie terreur, toujours à écumer le quartier comme un voyou femelle. Et maintenant, voilà qu’elle s’avisait de se pendre aux sonnettes et d’aller déranger le pauvre monde au moment où, la journée finie, on pouvait goûter un repos bien gagné.

Comme elles me détestaient ! Tonnerre de leurs voix qui s’entrecroisent et m’interpellent. Reproches, anathèmes, questions. À qui répondre ? Et que répondre ? Ronde de masques sur fond de ciel grimaçant, regards accusateurs qui m’épinglent au sol, papillon coupable d’avoir volé. On me crucifie, on m’écartèle. Au secours ! Au secours, Jeannot, ne m’abandonne pas.

Ma mère aussi m’avait fixée de ces yeux morts, m’avait parlé de cette bouche qui vomit les mots. Ah on pouvait dire que je l’avais déçue, elle qui avait rêvé d’une petite fille modèle à déguiser de falbalas, à enrubanner de gros nœuds multicolores. Dans son sein, ma mère avait cru réchauffer une poupée, et elle avait accouché d’un monstre, moi ! Il n’y avait pas longtemps que je l’avais surprise se plaignant à notre voisine, Mme Girard, la locataire du premier, avec qui nous partagions la resserre au fond du jardin. Je volais ! Sa propre fille, à sept ans tout juste, – elle vient à peine de les faire, on a fêté son anniversaire le mois dernier avec un gâteau, des bougies et tout, vous m’entendez, Mme Girard, elle n’est privée de rien, eh bien, elle tape dans la caisse !- . Elle en pleurait. Qu’est-ce qu’on allait pouvoir faire de moi, avec mes mauvais instincts ?
Quand elle m’avait aperçue, tapie au fond de la resserre sur un lit de sacs, serrant dans mes doigts crispés ma vieille poupée de chiffons, j’avais vu naître sur son visage cet air embarrassé et faraud dont elle fixait mon père quand il la convainquait de mensonge. Car elle mentait, elle aussi. Plusieurs fois, j’avais vu disparaître au fond de sa poche, un billet qu’elle aurait du déposer dans le tiroir-caisse. Pour acheter ceci ou cela dont mon père ne voulait absolument pas entendre parler. Je n’en avais rien dit. Femme de soumission, rapporteuse, donneuse des tiens, je te hais. Tout ce que je suis, tu le refuses. Un jour, je te détesterai.

Je l’avais prise, la pièce, moins par désir de mal faire que par amour des belles réglisses toutes rondes que personne ne m’achetait jamais. Les autres avaient une mère pour venir les chercher à la sortie de l’école. Dix minutes avant que ne sonne la cloche, des fenêtres de la classe où j’avais toujours quelque chose à faire à ce moment, je voyais s’agglutiner leur troupeau jacassant près du portail de sortie. Dès que nous jaillissions en courant et en criant, chacune s’emparait de son rejeton, et je les entendais houspiller mes copains tout au long du chemin. On n’avait pas le temps de musarder, il y avait le repas à servir, le petit frère à mettre à la sieste, tout un monceau de tâches dont le détail variait en fonction de ceux que je suivais. Cela ne les empêchait pas de s’arrêter, de mauvais gré, devant la boutique de la mère Tapedur. Comment résister ? Un enfant, ça vous use, ça vous corrode, c’est capable de répéter ses demandes à l’infini. Un jour, elles avaient cédé et n’avaient plus le moyen de refuser ce qui avait été, une fois, accordé. Ou alors, le coup d’éclat, mais c’est une mesure d’exception. Qui donc aurait la force d’en faire un chaque jour ?
Devant la vitrine, les mères et moi piétinions, attendant que leur progéniture ait fini de faire son choix entre les boîtes de dominos pleines à ras-bord de granules de réglisse, les têtes de nègres hilares, les petites souris de caramel enrobées de chocolat fondant et les coquillages débordants de sucre dur qui dure des heures et vous fait la langue râpeuse, puis écorchée, puis à vif. Comment se décider ?

Des merveilles, il y en avait partout dans le magasin bien trop pour qu’on puisse sans regrets lâcher sa grosse pièce de cinq francs. De chez la mère Tapedur, on partait toujours frustré, qu’on ait une pièce, ou deux, ou qu’on regarde, de l’extérieur, les autres choisir.

La mienne, de mère, ne s’impatientait jamais devant aucun portail, devant aucun magasin. Chaque jour, elle expédiait ma toilette et, le petit déjeuner à peine avalé, s’efforçait de se débarrasser de moi. C’était bon pour les autres d’avoir une mère exclusive. Moi, on me fourguait à qui voulait me prendre.
À la mère d’une petite voisine, parfois, à mon grand copain Jeannot, mon plus que frère. A Pierre même, quand on arrivait à lui mettre le grappin dessus, mais ça, c’était une autre affaire ! Il fallait se lever tôt et user de ruses de sioux pour débusquer mon frère. A treize ans, il fréquentait la classe du certificat d’études, avait ses amis, ses occupations. Qu’est-ce qu’il avait besoin d’une pisseuse accrochée à ses basques, à l’encombrer ! D’ailleurs, quand par extraordinaire, on avait réussi à l’épingler, je ne le gênais pas longtemps. Dès que nos parents avaient tourné le dos, il n’avait rien de plus pressé que de recommencer à courir, me laissant tricoter des gambettes loin, très loin derrière, pour essayer de le rattraper. Je savais d’avance que c’était peine perdue. Il avait sur moi neuf ans d’avance, et un, puis deux, puis une quantité innombrable de mètres que je renonçais bientôt à parcourir à son rythme.


À vrai dire, la gamine n’était qu’à demi responsable, cela se murmurait dans le quartier. Ils la laissaient traîner à sa guise. Ainsi livrée à elle-même, où vouliez-vous qu’elle aille ? Dans la rue, bien sûr, avec les galopins ! Après, la mère se plaignait qu’elle avait le diable en tête ! Il y a des gens qui n’ont pas de jugeote ! Ses pages d’écriture, on la voyait les faire dans la crasse et le cambouis de l’atelier des parents, perchée sur une chaise bancale, au milieu des vélos en réparation, des pneus entreposés, et des chambres à air classées par ordre de taille, sur une planche mal dégrossie posée sur deux tréteaux de fortune. Si vous croyez que c’est une vie, pour un gosse !

D’ailleurs, ces gens-là n’étaient recommandables en rien. Lui surtout, déplaisant, bourru, toujours l’air de se fiche du monde avec son accent espagnol et cette langue pleine d’images dont il usait quand il s’acharnait à vous expliquer ceci ou cela, qu’on ne comprenait pas, évidemment. S’ils veulent qu’on les entende, ils n’ont qu’à parler comme nous. Après tout, on ne leur a pas demandé de venir ! Personne ne savait seulement comment il s’appelait, ce type ! Ne parlons pas de reconstituer son arbre généalogique, comme on a coutume de le faire chez nous !
Il tenait avec sa femme un petit commerce de cycles qu’elle avait repris, plutôt mal que bien, à la mort de son premier mari : CYCLES JEUNES. Elle, dans le quartier, on l’appelait Mme Jeunes. Pour se le rappeler, il suffisait de regarder l’enseigne. Les enfants, on les disait les petits Jeunes. Mais lui, comment il s’appelait au juste, à part Antonio ? Ils s’appellent tous Antonio, les Espagnols, ou Paco, ou José. Angélo, c’est plutôt les Italiens. Ouvriers agricoles, ils sont les Italiens, ou maçons. Et les Espagnols, tout ce qu’on veut : valets de fermes, manutentionnaires, ouvriers dans les usines, terrassiers, manœuvres, commis, et durs à la peine, toujours prêts à faire des heures en plus pour manger le pain des Français. Une vraie racaille !

Dans cet atelier ils vivaient toute la journée, la femme plus encore que le mari. On se demandait parfois s’ils n’y couchaient pas aussi. Et ils avaient un travail ! Tout un peuple de manœuvres, de terrassiers, d’ouvriers-maçons, de gaffets, assiégeait en permanence l’atelier crasseux. Aucune femme honnête ne s’y serait risquée à certaines heures de la journée sous peine d’en sortir écarlate, sous les quolibets de ces voyous parlant à pleine gorge, riant gras et discutant de politique sur le ton de la diatribe en attendant qu’on ait fini de réparer. Dans cette ambiance, comment vouliez-vous qu’elle ne soit pas poussée au mal, la gamine ?

Pour l’heure, elle ne songeait pas à faire la bravache, la fille de l’Espagnol ! L’oreille en feu dans les doigts en tenailles de Madame Duguez, je planais, les pieds à vingt centimètres du sol, le visage maculé de larmes et de poussière, encadrée d’un bataillon de jupons en colère qui s’étaient mis en route vers l’atelier de mes parents. Et l’angoisse, je ne dis rien de l’angoisse !
Avant que ne se produise un drame, on dit que certains êtres en sont avertis par des pressentiments. Ma mère était coutumière du fait. A chaque fois qu’il nous était arrivé un accident, (quand Pierre avait failli passer sous la faucheuse de l’oncle Mario, le mari de la tante Ermengilda; quand j’étais restée pendue par une main au crocher à peler les porcs pour avoir tenté de faire de l’alpinisme avec Jeannot sur le tas de bûches des Girard, dans notre resserre commune), à chaque fois, ma mère nous avait ensuite narré par le menu les sensations, angoisses et tourments, qui l’avaient informée, par avance, de l’imminence du désastre. Une preuve de plus, si le besoin s’en faisait sentir, que je n’étais en rien sa fille : ce soir-là, je n’avais été effleurée d’aucun pressentiment. J’étais si heureuse avant que les trois viragos ne jaillissent, comme des diables de leurs boîtes, pour s’emparer de moi et me conduire au sacrifice.

Mes larmes coulent d’elles-mêmes. La souffrance demeure extérieure, brûlure à l’endroit où se recourbent les doigts en serre de Mme Duguez. Au dessus de moi, sur le ciel d’un bleu cru, se détachent leurs visages durcis. Figures de proue naviguant de conserve, elles fendent l’air de leurs corps sculpturaux. Elles me traînent, minuscule, abandonnée à leur violence, à ma panique, vers la succession de pièces en enfilade où mes parents ont installé leur atelier. L’instant s’écoule, infini. Puissions-nous ne jamais cesser de nous mouvoir dans cet air sirupeux que l’odeur des jasmins et des seringas épanouis dans les jardins voisins épaissit jusqu’au malaise. Puissions-nous n’arriver jamais !

Notre caravane tourne à angle droit, s’immobilise. Nos yeux, éblouis par la lumière extérieure, ont du mal à accommoder. L’espace s’est réduit à un boyau. Noirs les murs couverts de cambouis, noir le sol anciennement de brique rose. La fraîcheur est celle d’une grotte.
Tout au fond, son corps trapu aux grandes mains dressé devant l’établi, mon père, chalumeau en main, environné d’étincelles qui retombent en pluie, décalamine un pot d’échappement. Dieu forgeron, Vulcain au poing de braise et aux yeux de menthe poivrée, il regarde avancer notre procession dans un silence glacé. N’était leur poigne qui faiblit un peu, je m’enfuirais à toutes jambes, je m’anéantirais plutôt que d’avoir à affronter cette force silencieuse qui se ramasse pour bondir.
Odeur entêtante de la calamine, fumée qui pique les yeux, envie de hurler, vertige… Pardon, papa… pas fait exprès…voulais pas faire de mal… aide-moi, mon papa… Les pensées se forment, surnagent un moment, puis sombrent dans le chaos de ma terreur.
De ma mère, rien à attendre. Depuis notre irruption, elle n’a pas levé son visage rechigné ni ses yeux obstinément fixés sur le moteur à réparer. Elle ne fera pas le moindre geste pour me défendre de lui, ni d’elles. Cependant, leurs poignes se relâchent. Je les sens qui vacillent, qui perdent pied. La troupe continue sur sa lancée, mais la chevauchée fantastique tourne en cavalcade. La queue avance plus vite que la tête. Le groupe se désarticule.

Quand mon père commence à parler, une stupeur fige les chasseresses. Elles allaient à la curée et voilà que la proie leur fait face, révélant des dents de loup. Il a une belle voix, mon père, puissante, chaude, une voix d’homme qui aime les mots et a l’habitude de les manier. Il demande ce qu’il peut faire. Il ne m’a donc pas vue, hagarde, au milieu d’elles ?

Flottement dans la troupe. Un mouvement les tire vers l’arrière. Une seconde encore et ce sera la déroute. L’instant est suspendu.
Mais la Duguez tient tête, ses yeux étincelants rivés à ceux de mon père. Le groupe reprend courage. Colère de chats. Immobiles, tendus, ils se soupèsent du regard, s’affrontent, se toisent, se dansent autour, souples sur leurs jambes aux muscles bandés. Il avance, elle recule, il se replie, elle gagne du terrain. Nous suivons, fascinées, les phases de l’approche. Toutes sauf ma mère qui continue son travail, penchée sur la pièce à changer, la lumière éblouissante de la balladeuse éclairant, par en-dessous, son visage sculpté dans un bois dur.

C’est mon père qui gagnera. Il est plus massif, plus calme. La Duguez, frénétique, s’épuise en attaques désordonnées, en feintes, en sournoises accusations. Il laisse dire, le visage immobile. Comprend-il seulement ce qu’elle veut de lui, de nous ?
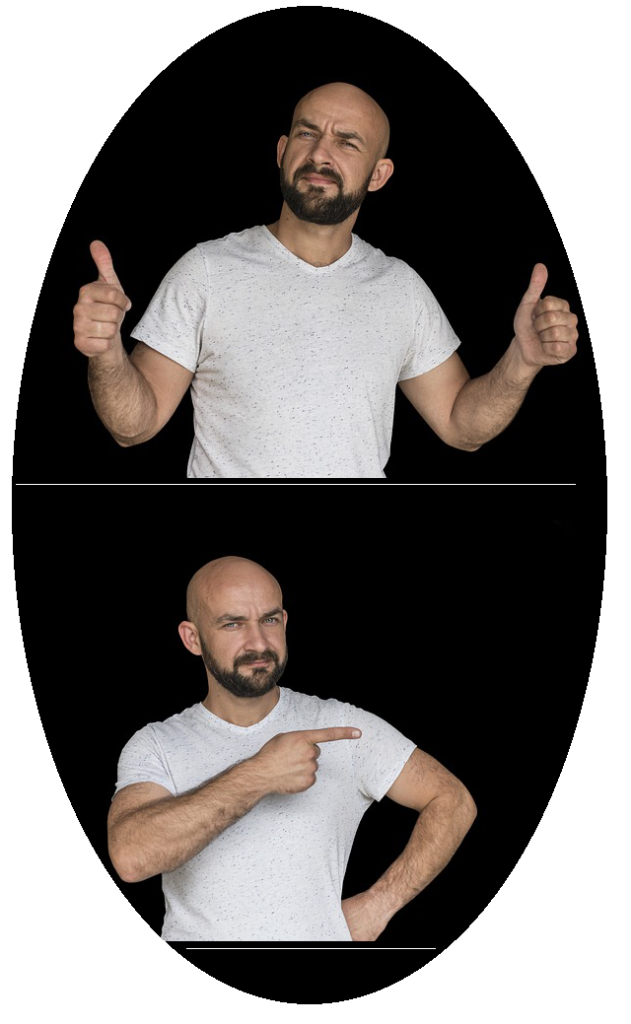
Le voilà qui soliloque, cessant par moments de se parler pour prendre le groupe à témoin : une si petite fille, tirer les sonnettes, qui aurait pu y croire ?… Oh, il ne les met pas en cause ! De si bonnes voisines ! Et si, en plus, elles m’ont prise sur le fait !… Comment, elles ne sont sorties qu’après ? Mais c’est que ça change tout ! Qu’est-ce qui peut leur avoir donné l’idée saugrenue de m’accuser, alors ?
Il approche de sa démarche chaloupée, un ours partant en chasse. Le groupe recule, moi au milieu, emportée par la même vague d’épouvante. Mais la Duguez tient tête, vipérine, le bras prêt à se lever pour parer les coups.
Il arrive, il est sur nous. Il prend ma main, me tire, (comme au jeu de ballon prisonnier, tu touches l’autre, il est délivré), m’attire jusqu’à lui, me fait tourner sur moi-même, laisse aller son regard sur elles qui pâlissent un peu. Le temps s’arrête. Il me fait lever le bras, marque dans l’espace ma mesure.
– Encore un petit effort, Eva…
Il prononce mon nom à l’espagnole, accentuant fortement le è, terminant par une syllabe courte, èèèèèba, une caresse, un encouragement.
– …tire-toi bien sur la pointe des pieds… tu ne peux pas aller plus haut, c’est sûr ?
Puis s’adressant à elles :
– Elles sont à cette hauteur, vos sonnettes ? Comment elle a pu faire, la gamine ? Et même si elle n’était pas si petite, vous avez déjà essayé de sonner à trois portes en même temps ? Je ne la savais pas si rapide !

Leurs regards vacillent. Un malaise plane. Et si elles s’étaient trompées ? Elles sont entrées dans leur bon droit et voilà qu’on argumente, qu’on les pousse dans leurs derniers retranchements, voilà qu’elles vont sortir coupables. Elles ne savent plus que penser. Impitoyablement, il pousse son avantage :
– Dis-nous, ma petite, tu peux parler maintenant. Tu n’as pas sonné, d’accord, mais peut-être tu les as vus, les mauvais drôles ? Dis à ces dames qui ils sont, ou bien c’est toi qui va payer pour les autres, ma pauvrette !

Tandis que des ondes parcourent le groupe vers l’avant, vers l’arrière, le décomposant sous son œil implacable, la Duguez tente une dernière parade :
– Mais alors, si elle n’a rien fait, pourquoi s’enfuyait-elle à toutes jambes, ce n’est pas une preuve, ça ? On ne se sauve pas si on n’a rien à se reprocher.
– Sauf si votre mère vient de vous appeler, c’est bien ce que tu venais de faire, non ? On n’attendait plus qu’elle pour fermer, il est tard.
Tandis que ma mère, tête basse, aquiesce sans bouger, dans le groupe, c’est la débandade. Balbutiant des mots incohérents, elles se replient en désordre.
Mon père et ma mère reprennent leur tâche, côte à côte. Si au moins, ils me regardaient, s’ils me grondaient ! Ils ont menti pour moi et il semble que je n’existe pas ! Je vais de l’un à l’autre sans qu’ils paraissent me voir, j’étouffe. Loin de leur regard, je suis séparée du monde. Je m’accroche à la jambe de mon père, j’enfouis mon visage dans ses cuisses en gémissant. Qu’importe la lourde odeur du cambouis, le tissu gras sur lequel se crispent mes doigts, glissent mes joues ? Il faut qu’il baisse sur moi se yeux glacés, qu’il me protège des forces du mal guettant les petites filles abandonnées. De très haut, il se penche vers moi, (va-t-il me battre ?), me saisit de ses grandes mains, me perche sur sa hanche. Ses yeux plongent dans les miens, limpides et froids comme des lames.

– Tu vois, Nénéta…
Je frémis sous cette caresse. Néna, petite fille. Nénéta, mon petit bout de fille. Il ne m’abandonne pas, même s’il me tient éloignée pour enfoncer en moi la vrille de son regard quand je n’aspire qu’à me blottir, à me pelotonner. Lui et moi avons l’habitude de ces corps à corps où c’est toujours le plus petite qui gagne. Toujours, sauf aujourd’hui où nous ne nous emmêlons pas, où il me tient à distance pour mieux me sonder de ses yeux durs :
– Tu vois, Nénéta, le mieux, c’est de ne pas mentir, mais si, un jour, tu y es obligée, alors que ton mensonge ait des racines. Et pour les sottises, c’est pareil. Avant d’en faire une, réfléchis bien. Après, peut-être que tu l’éviteras, mais si tu la fais quand même, tu n’iras pas te laisser attraper bêtement, à la place des autres. »
Pendant que ma mère finit de ranger l’atelier, les gestes saccadés, le visage comme du bois, je cache ma tête dans son cou, pour échapper à son regard et je sens vibrer la douceur de sa voix contre mon front. Je suis la fille de mon père.
Un jour, je te détesterai.
